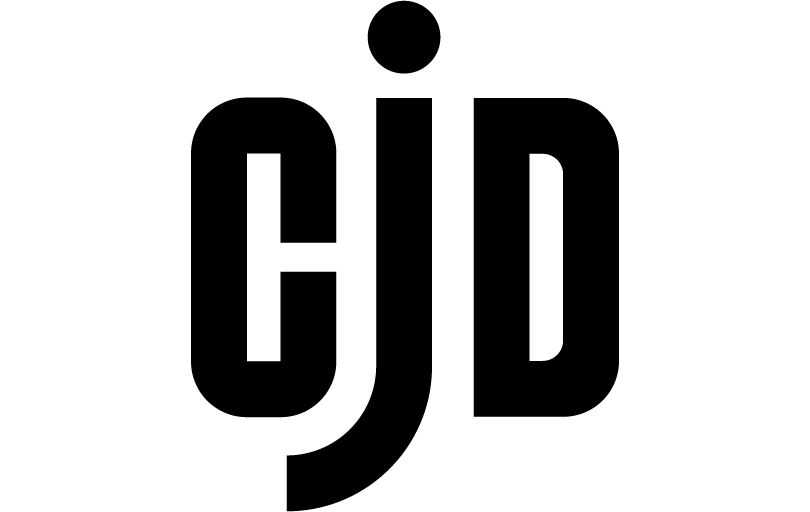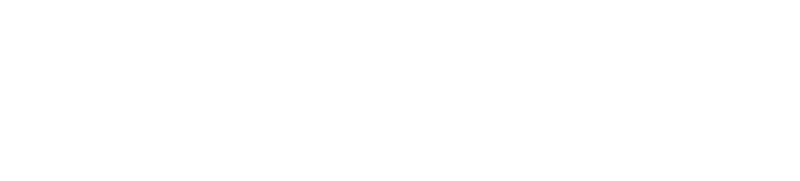Dans l’article précédent, nous avons vu combien il pouvait être important de placer des lignes rouges pour se protéger l’abus. La loi, au fond, est une grande opération de traçage de lignes rouges ; et pas seulement la loi, mais la culture, les usages. Parfois, pourtant, il faut franchir les lignes rouges.
La guerre entre les cités grecques a pris un temps la forme de l’affrontement hoplitique. C’est-à-dire des citoyens, équipés de même (assez lourdement), en nombre égal de chaque côté, en un temps et un endroit prévus par les adversaires. Quelque chose qui ressemble au fond à un match de football ou autre sport collectif, à part que le choc était là assez sanglant. Assez sanglant, mais qui permettait aux combattants rescapés de rentrer tranquillement chez eux le soir, qui permettait aux autres citoyens de ne pas craindre le pillage et autres plaies épouvantables.
Puis, pendant la guerre du Péloponnèse, les choses ont pris un autre tour, notamment avec l’irruption de la ruse dont j’ai déjà parlé (embuscade, attaques de nuit, empoisonnement de l’eau, etc.), et les lignes rouges qui étaient finalement respectées jusque là — ne serait-ce que l’enceinte des cités —, ont été franchies.
À la guerre, ces lignes rouges et leur franchissement s’invitent aujourd’hui dans l’actualité : violations de la convention de Genève, avec des armes chimiques par exemple.
S’imposer
Franchir les lignes rouges nous expose à l’escalade de la violence et je ne saurais encourager personne à le faire. Dans l’histoire, cette escalade a amené à des guerres d’anéantissement, l’extrême de la violence. Néanmoins, que faire quand vos adversaires le font et commencent à être « déloyaux » et à cesser de se comporter comme des gentlemen ? Que faire lorsqu’ils ne respectent plus les règles. Que faire lorsque l’autre « triche » ?
Ne rien faire, se cantonner dans ce qui est licite est s’exposer à la défaite. Libre à nous ensuite de nous plaindre et de gémir. Les recours éventuels ne nous donneront que rarement satisfaction.
Au contraire, lâcher toute retenue et s’engager dans un combat hors la loi où, puisque l’autre triche, tout est permis, risque de nous engager hors de tout cadre, c’est-à-dire dans des endroits dangereux. Tout le monde n’est pas prêt à vivre comme un malfaiteur ou un terroriste.
De la mesure dans la démesure, voilà qui semble être le maître mot. Montrer à l’autre que nous ne sommes pas de gentils agneaux et que s’il veut « jouer », il va nous trouver. L’idée, tout comme l’établissement des lignes rouges, est d’apparaître comme une personne potentiellement dangereuse. Si l’autre ne respecte pas les règles, aucune raison de se montrer gentil et docile ; se faire craindre n’est pas toujours un mal ; c’est même parfois une condition de survie et je préfère que vous apparaissiez comme un fou dangereux que comme une cible facile.
Toute ensuite réside dans votre propre vertu et ne pas devenir au fond de vous-même tel que vous pouvez apparaître dans certaines circonstances…
Les autres articles de la série :