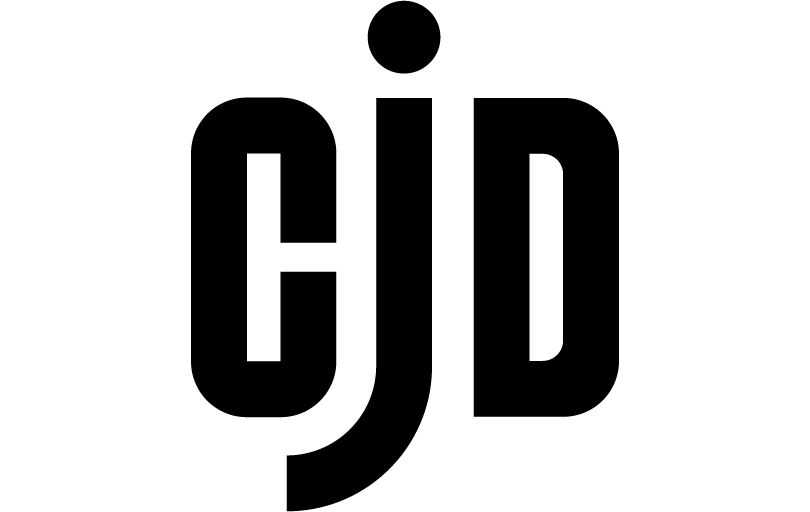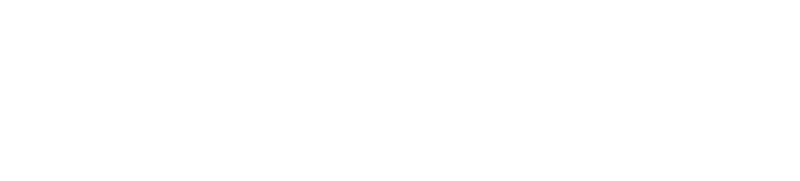Les auteurs sur Wikipédia ne s’entendent pas sur la définition de « récession ». Le mois dernier, le site a été contraint d’interdire aux nouveaux utilisateurs anonymes de modifier la page consacrée à ce mot après la polémique portant sur l’affirmation selon laquelle deux trimestres consécutifs de baisse du PIB indiquent une récession. La page, qui n’avait auparavant été modifiée que 24 fois en 2022, a été modifiée à 180 reprises en une semaine. Le débat ne s’est pas cantonné à Internet et à Wikipédia. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, la qualification d’une période en récession génère d’intenses débats. Alors, quand on parle de récession (comme c’est particulièrement le cas aujourd’hui), de quoi parle-t-on vraiment ?
Une récession se caractérise par une forte baisse de l’activité économique se traduisant par un recul de la production, de l’investissement et de l’emploi. Les revenus des entreprises comme des ménages sont logiquement orientés à la baisse. La crise financière mondiale de 2007-09 a réduit de près de 4 % la croissance économique mondiale.
La valse des indicateurs
Dans certains pays, dont la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, la convention veut que deux trimestres de croissance négative du PIB indiquent une récession. Mais de nombreux économistes estiment que cette définition est trop étroite. Le Japon utilise plusieurs indicateurs, notamment la production, les ventes au détail et l’emploi pour apprécier l’existence ou non d’une récession.
Le gouvernement américain quant à lui s’en remet au National Bureau of Economic Research, un groupe de recherche privé à but non lucratif pour déterminer si le pays est en récession. Un panel de huit économistes, connu sous le nom de Business Cycle Dating Committee est ainsi l’arbitre américain des récessions depuis 1978. Comme au Japon, le comité définit une récession en utilisant une série de facteurs, y compris l’emploi, le revenu des ménages et la production industrielle. Le critère du PIB est jugé insuffisant pour déterminer le développement ou pas d’une récession. Ce comité considère qu’actuellement les États-Unis ne sont pas en récession. L’emploi est toujours en forte croissance. Le chômage est faible et la croissance de l’emploi robuste : le pays a créé 528 000 emplois en juillet, soit plus du double des attentes. Les revenus des entreprises et des ménages augmentent.
Erreurs d’appréciation
Ce comité estime que les jugements en temps réel sont sujets à d’importantes erreurs d’appréciation. En 2012, une récession a été à tort diagnostiquée au Royaume-Uni. Si officiellement les États-Unis ont été en récession entre 2008 et 2009, dans les faits, cette dernière avait commencé dès 2007. L’opinion est peu sensible aux arguties des économistes. Elle est en règle générale plus pessimiste que ces derniers. Selon une enquête réalisée par CNN en juillet ; 64 % des personnes interrogées estimaient qu’une récession avait, aux États-Unis, déjà commencé. En juin, 73 % des Britanniques répondant à un sondage Ipsos pensaient de même pour leur pays.
Au-delà des débats sémantiques, une récession est annoncée au Royaume-Uni comme en Allemagne.
Le Royaume-Uni est confronté aux effets du Brexit et à la faiblesse des mesures de soutien aux ménages quand l’Allemagne doit faire face à une crise industrielle du fait de l’augmentation des coûts de production. La transition énergétique pénalise fortement le secteur automobile qui a été, en outre, fortement touché par la pénurie des microprocesseurs. La récession pourrait durer de trois à cinq trimestres, mais, en la matière, les prévisions n’engagent que ceux qui les écoutent.
Crédit Photo : Can Stock Photo – PixelEmbargo